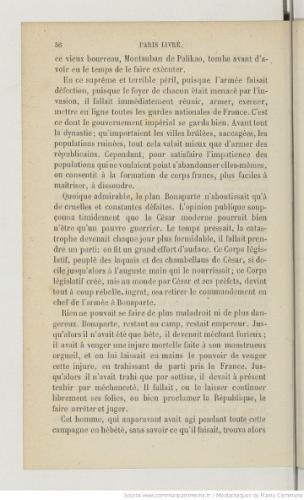Fil d'Ariane
- Accueil
- Paris livré, de Gustave Flourens 2/2
Paris livré, de Gustave Flourens 2/2
Paris livré, que Flourens écrit en quelques semaines entre sa libération de Mazas, le 21 janvier 1871, et le déclenchement de la Commune, le 18 mars, est une sorte d’Étrange Défaite (Marc Bloch) mais dont l’auteur aurait trempé sa plume dans l’encrier des Châtiments (Victor Hugo). Dans une veine pamphlétaire donc, Flourens y décrit sa vision de la défaite de 1870 et des raisons qui y ont conduit. Il n’a pas de mots assez durs, non seulement pour l’Empire, dont les généraux ont continué de commander aux armées de la République, mais aussi pour le gouvernement de la Défense nationale, avec en ligne de mire Louis-Jules Trochu (qui le préside), Jules Favre (son ministre des Affaires étrangères) et, dans une moindre mesure, Léon Gambetta (ministre de l’Intérieur). Contre ceux-là, Paris livré sert aussi de mémoires et de justification à Flourens qui, détail amusant, y parle de lui à la troisième personne (« Flourens »). Il y décrit ainsi longuement son rôle dans la journée du 31 octobre et oppose sa version à celle de Millière, qui l’a accusé d’hésitations.
-
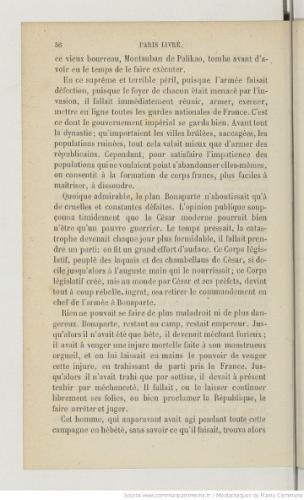
Un livre à charge
Au service de sa thèse, Flourens retrouve, jusque dans l’outrance, les accents de 1793 : « Ordonner en province la levée en masse, et la faire exécuter sérieusement. Quand les toits brûlent, quand les femmes sont violées, les enfants écrasés par les obus, il n’est plus permis à personne de n’aimer point la guerre et de rester chez soi. Envoyer à tout homme en âge de porter les armes sa feuille de route. Mettre les gendarmes à la poursuite des retardataires, fusiller les récalcitrants. (p. 67) » Il est vrai qu’il tempère cet enthousiasme par l’alternative qu’il propose en « épilogue » (p. 220 et suivantes) : après le 4 septembre, on aurait pu « conclure immédiatement la paix avec la Prusse ». C’est ce qu’il appelle « la solution américaine, celle des gens pratiques » : « Mise à ce régime fortifiant et salubre, la France serait devenue digne de tenir sa place parmi les peuples libres ». À cette solution américaine, qu’il juge honorable, il oppose « la solution française » : « celle des enthousiastes, qui consistait à se battre. Mais révolutionnairement, comme en 1793, guerre à outrance, vaincre ou mourir. » Pour lui, le gouvernement de la Défense nationale a choisi une solution intermédiaire, « bâtarde et funeste » : faire la guerre, mais sans se donner les moyens de vaincre. Il y discerne même un plan machiavélique, caché, celui de persuader, par les souffrances et la défaite, le peuple des enthousiastes d’accepter son sort. Au besoin, souffrances et défaite réaliseraient un autre objectif, inavoué, celui de mettre les républicains au pas.
Au nom de la « solution française », Flourens propose son propre plan, celui du « bon sens » : appel à la révolution à l’étranger, destitution de tous les officiers bonapartistes à l’intérieur et promotion des sous-officiers républicains, « fusiller tout traître qui parle de reddition », faire sortir de Metz et Paris toutes les forces disponibles pour, d’une part, harceler les arrières ennemis, et, d’autre part, défendre Paris, « ordonner en province la levée en masse », « faire coudre à toutes les femmes des vêtements solides et chauds pour les soldats de la République », « dans Paris, constituer une garde nationale invincible », changer de tactique militaire, enfin, « Faire de suite les élections municipales de Paris » : « Qui pouvait mieux que les élus du peuple, magistrats populaires, (…) faire accepter les souffrances du rationnement, si elles devenaient nécessaires, les adoucir par des ménagements et des égards infinis ; (…) et introduire enfin, grâce au siège, doucement et tout naturellement, l’égalité dans les mœurs, la justice dans les relations sociales. (pp. 64-70) »
Si la flamme de l’enthousiasme de Flourens évoque irrésistiblement celle de la Résistance française de 1940, le programme en est, on le voit, bien différent. Là où De Gaulle s’appuie sur des militaires de carrière pour faire la guerre à l’extérieur (FFL) et sur une « minorité agissante » à l’intérieur, « léniniste » en somme, jusque dans sa composition (FFI), Flourens propose en quelque sorte l’inverse : des minorités révolutionnaires à l’étranger, et la levée en masse sur le territoire national. Ce programme, hérité de 1793, pouvait-il réussir en 1871 ? Flourens, qui aura tenté, à son échelle réduite, de l’appliquer lors de la sortie du 3 avril 1871, se désespèrera d’y avoir échoué, au point, peut-être, de se laisser prendre (volontairement ?).
Reste que Paris livré demeure un témoignage précieux pour l’historien, pour « capter » l’esprit de l’époque. Plus proche de la majorité jacobine du Conseil de la Commune que de ses composantes socialistes ou anarchistes, Flourens fait preuve d’un enthousiasme révolutionnaire touchant, mais hasardeux. Sa haine de l’Empire lui fait brosser, par contraste, un portrait flatteur de la Prusse, qui n’est pas sans évoquer certains débats actuels sur les mérites comparés de l’Allemagne et de la France : « Entre la Prusse et la France quel saisissant contraste ! Sans bruit, sans vanteries, sans fatiguer les échos du monde entier de cris d’admiration niaise d’eux-mêmes, de perpétuels éloges de leurs mérites, les Prussiens travaillaient patiemment, obstinément à devenir un grand peuple. » Paris livré vaut également pour sa description des prodromes de la Commune, et notamment de la journée du 31 octobre, dans laquelle Flourens joue un rôle si éminent (chapitres III à X de la troisième partie).
Pour le lecteur curieux, c’est le cri de révolte, forcément frappant, forcément touchant, d’un esprit brillant et généreux, l’expression d’une certaine forme du « génie français », dans une langue belle et vibrante : « Il faut à l’Europe, si elle ne veut finir bientôt comme le Bas-Empire romain, un principe nouveau qui la sauve du bourbier monarchique ; (…) Un principe fécond en institutions capables d’assurer la sécurité des peuples, de prévenir à tout jamais le retour de ces antiques fléaux de l’humanité, l’absolutisme monarchique, les castes, la théocratie, les luttes internationales. Ce principe, le peuple l’a ; il l’aime, il le défend de toutes ses forces, il veut le faire triompher à tout prix. Ce principe n’a jamais été appliqué politiquement dans le monde. Il y a seulement été prêché au point de vue sentimental et religieux. Et pourtant, il peut seul sauver l’humanité, parce qu’il est la justice. Il peut seul fonder l’ordre et la liberté, déshabituer du brigandage les nations et les individus, (…) créer enfin un nouveau monde, une jeune Europe toute différente de l’ancienne. Ce principe, c’est l’égalité ! (p. 225) ».
Sources
Paris livré, Gustave Flourens, Paris : A. Le Chevalier, 1872
Dictionnaire de la Commune, Bernard Noël, [s. l.] : Mémoire du livre, 2000
Les Hommes de la révolution de 1871 : Gustave Flourens, Charles Prolès, Paris : Dépôt général, 1898
La Commune de Paris : 1871, William Serman, Paris : Fayard, 1986
Paris, bivouac des révolutions : la Commune de 1871, Robert Tombs, Paris : Libertalia, 2014
Un livre à charge
Au service de sa thèse, Flourens retrouve, jusque dans l’outrance, les accents de 1793 : « Ordonner en province la levée en masse, et la faire exécuter sérieusement. Quand les toits brûlent, quand les femmes sont violées, les enfants écrasés par les obus, il n’est plus permis à personne de n’aimer point la guerre et de rester chez soi. Envoyer à tout homme en âge de porter les armes sa feuille de route. Mettre les gendarmes à la poursuite des retardataires, fusiller les récalcitrants. (p. 67) » Il est vrai qu’il tempère cet enthousiasme par l’alternative qu’il propose en « épilogue » (p. 220 et suivantes) : après le 4 septembre, on aurait pu « conclure immédiatement la paix avec la Prusse ». C’est ce qu’il appelle « la solution américaine, celle des gens pratiques » : « Mise à ce régime fortifiant et salubre, la France serait devenue digne de tenir sa place parmi les peuples libres ». À cette solution américaine, qu’il juge honorable, il oppose « la solution française » : « celle des enthousiastes, qui consistait à se battre. Mais révolutionnairement, comme en 1793, guerre à outrance, vaincre ou mourir. » Pour lui, le gouvernement de la Défense nationale a choisi une solution intermédiaire, « bâtarde et funeste » : faire la guerre, mais sans se donner les moyens de vaincre. Il y discerne même un plan machiavélique, caché, celui de persuader, par les souffrances et la défaite, le peuple des enthousiastes d’accepter son sort. Au besoin, souffrances et défaite réaliseraient un autre objectif, inavoué, celui de mettre les républicains au pas.
Au nom de la « solution française », Flourens propose son propre plan, celui du « bon sens » : appel à la révolution à l’étranger, destitution de tous les officiers bonapartistes à l’intérieur et promotion des sous-officiers républicains, « fusiller tout traître qui parle de reddition », faire sortir de Metz et Paris toutes les forces disponibles pour, d’une part, harceler les arrières ennemis, et, d’autre part, défendre Paris, « ordonner en province la levée en masse », « faire coudre à toutes les femmes des vêtements solides et chauds pour les soldats de la République », « dans Paris, constituer une garde nationale invincible », changer de tactique militaire, enfin, « Faire de suite les élections municipales de Paris » : « Qui pouvait mieux que les élus du peuple, magistrats populaires, (…) faire accepter les souffrances du rationnement, si elles devenaient nécessaires, les adoucir par des ménagements et des égards infinis ; (…) et introduire enfin, grâce au siège, doucement et tout naturellement, l’égalité dans les mœurs, la justice dans les relations sociales. (pp. 64-70) »
Si la flamme de l’enthousiasme de Flourens évoque irrésistiblement celle de la Résistance française de 1940, le programme en est, on le voit, bien différent. Là où De Gaulle s’appuie sur des militaires de carrière pour faire la guerre à l’extérieur (FFL) et sur une « minorité agissante » à l’intérieur, « léniniste » en somme, jusque dans sa composition (FFI), Flourens propose en quelque sorte l’inverse : des minorités révolutionnaires à l’étranger, et la levée en masse sur le territoire national. Ce programme, hérité de 1793, pouvait-il réussir en 1871 ? Flourens, qui aura tenté, à son échelle réduite, de l’appliquer lors de la sortie du 3 avril 1871, se désespèrera d’y avoir échoué, au point, peut-être, de se laisser prendre (volontairement ?).
Reste que Paris livré demeure un témoignage précieux pour l’historien, pour « capter » l’esprit de l’époque. Plus proche de la majorité jacobine du Conseil de la Commune que de ses composantes socialistes ou anarchistes, Flourens fait preuve d’un enthousiasme révolutionnaire touchant, mais hasardeux. Sa haine de l’Empire lui fait brosser, par contraste, un portrait flatteur de la Prusse, qui n’est pas sans évoquer certains débats actuels sur les mérites comparés de l’Allemagne et de la France : « Entre la Prusse et la France quel saisissant contraste ! Sans bruit, sans vanteries, sans fatiguer les échos du monde entier de cris d’admiration niaise d’eux-mêmes, de perpétuels éloges de leurs mérites, les Prussiens travaillaient patiemment, obstinément à devenir un grand peuple. » Paris livré vaut également pour sa description des prodromes de la Commune, et notamment de la journée du 31 octobre, dans laquelle Flourens joue un rôle si éminent (chapitres III à X de la troisième partie).
Pour le lecteur curieux, c’est le cri de révolte, forcément frappant, forcément touchant, d’un esprit brillant et généreux, l’expression d’une certaine forme du « génie français », dans une langue belle et vibrante : « Il faut à l’Europe, si elle ne veut finir bientôt comme le Bas-Empire romain, un principe nouveau qui la sauve du bourbier monarchique ; (…) Un principe fécond en institutions capables d’assurer la sécurité des peuples, de prévenir à tout jamais le retour de ces antiques fléaux de l’humanité, l’absolutisme monarchique, les castes, la théocratie, les luttes internationales. Ce principe, le peuple l’a ; il l’aime, il le défend de toutes ses forces, il veut le faire triompher à tout prix. Ce principe n’a jamais été appliqué politiquement dans le monde. Il y a seulement été prêché au point de vue sentimental et religieux. Et pourtant, il peut seul sauver l’humanité, parce qu’il est la justice. Il peut seul fonder l’ordre et la liberté, déshabituer du brigandage les nations et les individus, (…) créer enfin un nouveau monde, une jeune Europe toute différente de l’ancienne. Ce principe, c’est l’égalité ! (p. 225) ».
Sources
Paris livré, Gustave Flourens, Paris : A. Le Chevalier, 1872
Dictionnaire de la Commune, Bernard Noël, [s. l.] : Mémoire du livre, 2000
Les Hommes de la révolution de 1871 : Gustave Flourens, Charles Prolès, Paris : Dépôt général, 1898
La Commune de Paris : 1871, William Serman, Paris : Fayard, 1986
Paris, bivouac des révolutions : la Commune de 1871, Robert Tombs, Paris : Libertalia, 2014-